conversation
conversation
ARTUS DE LAVILLÉON
Artiste polymorphe
Le travail d’Artus porte à la fois sur le “témoignage brutal de vécu” et “l’archivage du quotidien” à travers des dessins en N&B, des photographies, performances etc. il est également le fondateur du mouvement Art Posthume et auteur des fanzines Dead Pan.
Nous nous sommes retrouvés au Select où nous avons parlé de notre rapport à la réalité à travers les écrans, de photographies ratées, de fiction qui s'immisce dans la réalité mais aussi du courant anthroposophique et de Hilma Af Klimt. Entre autres…





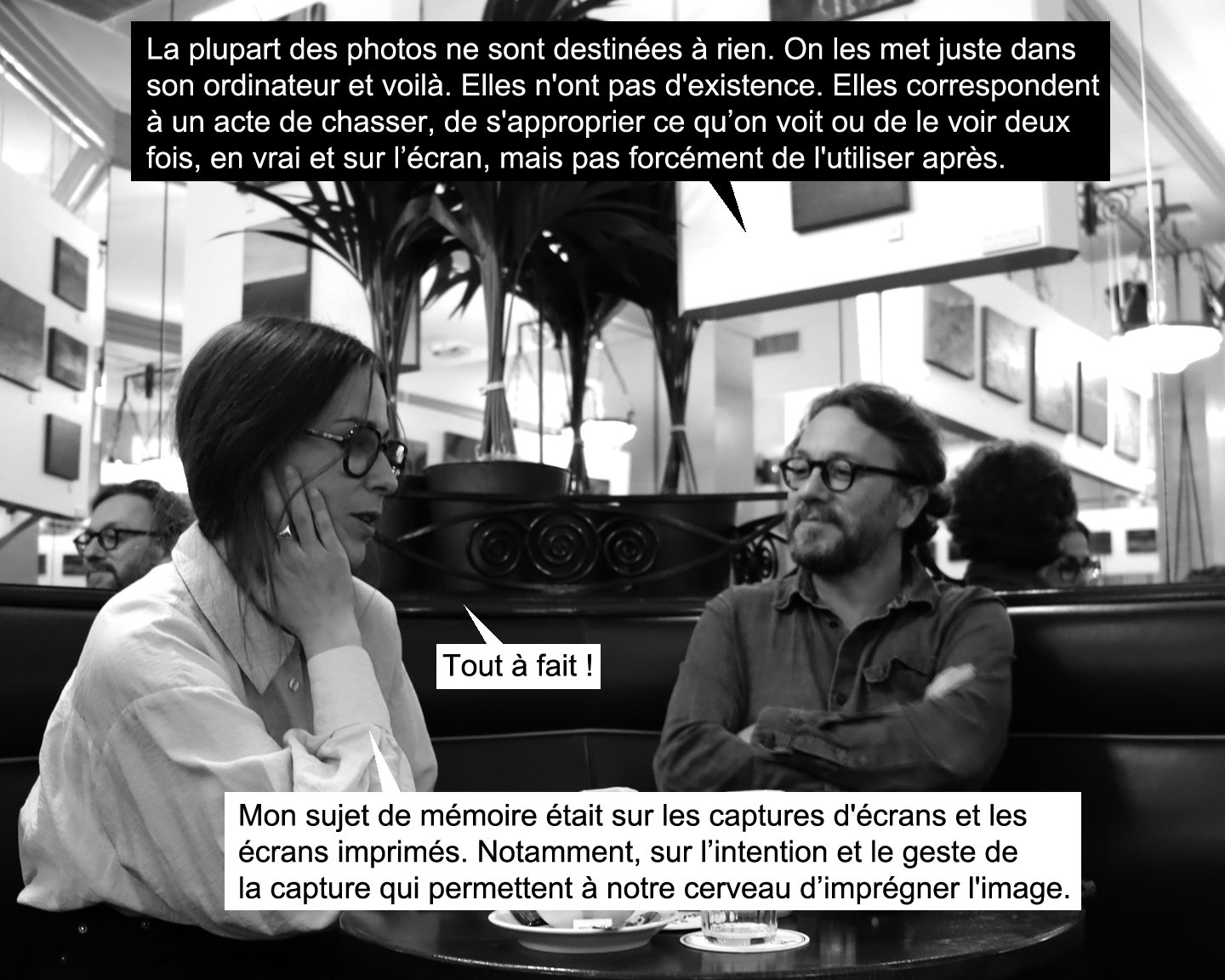
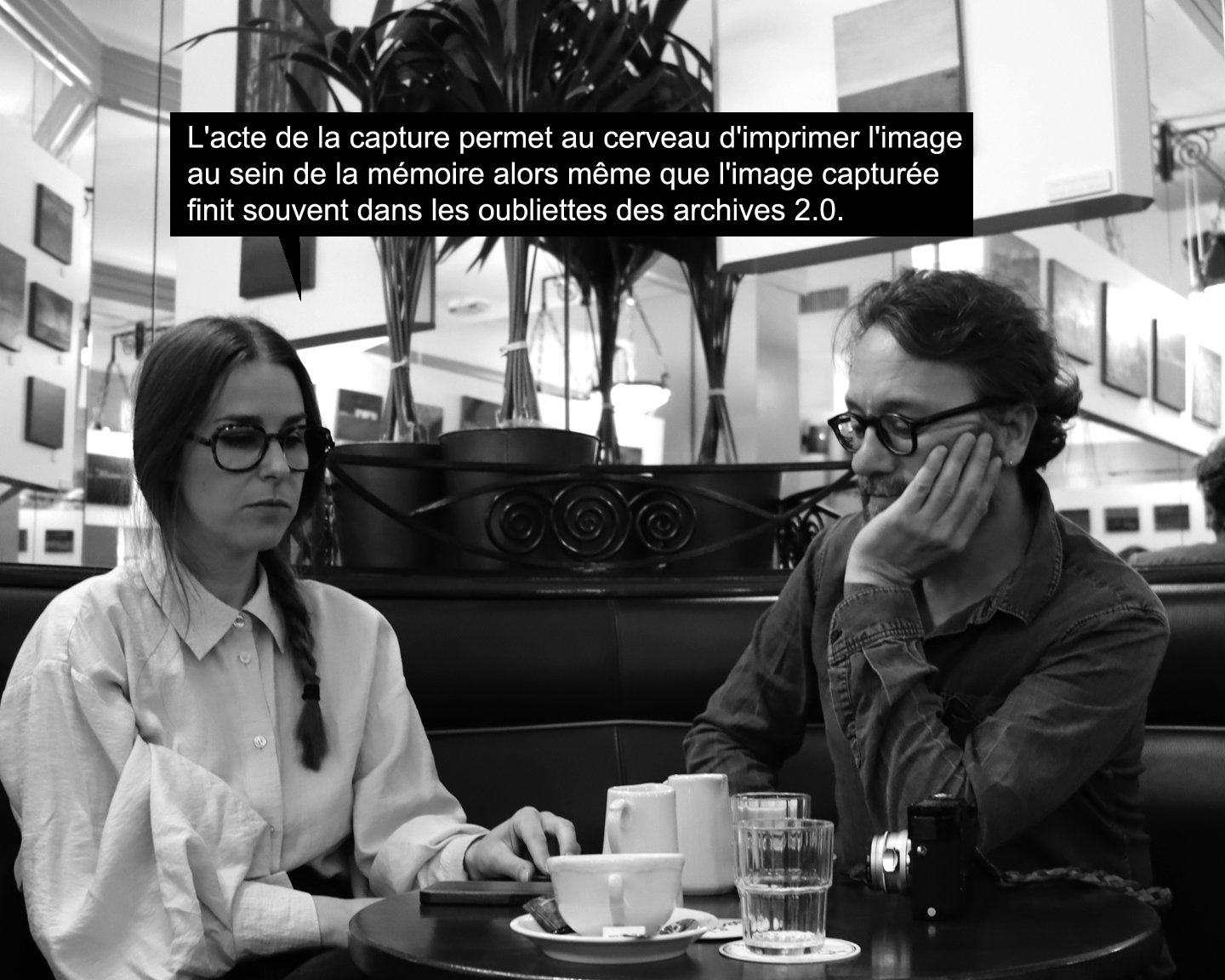



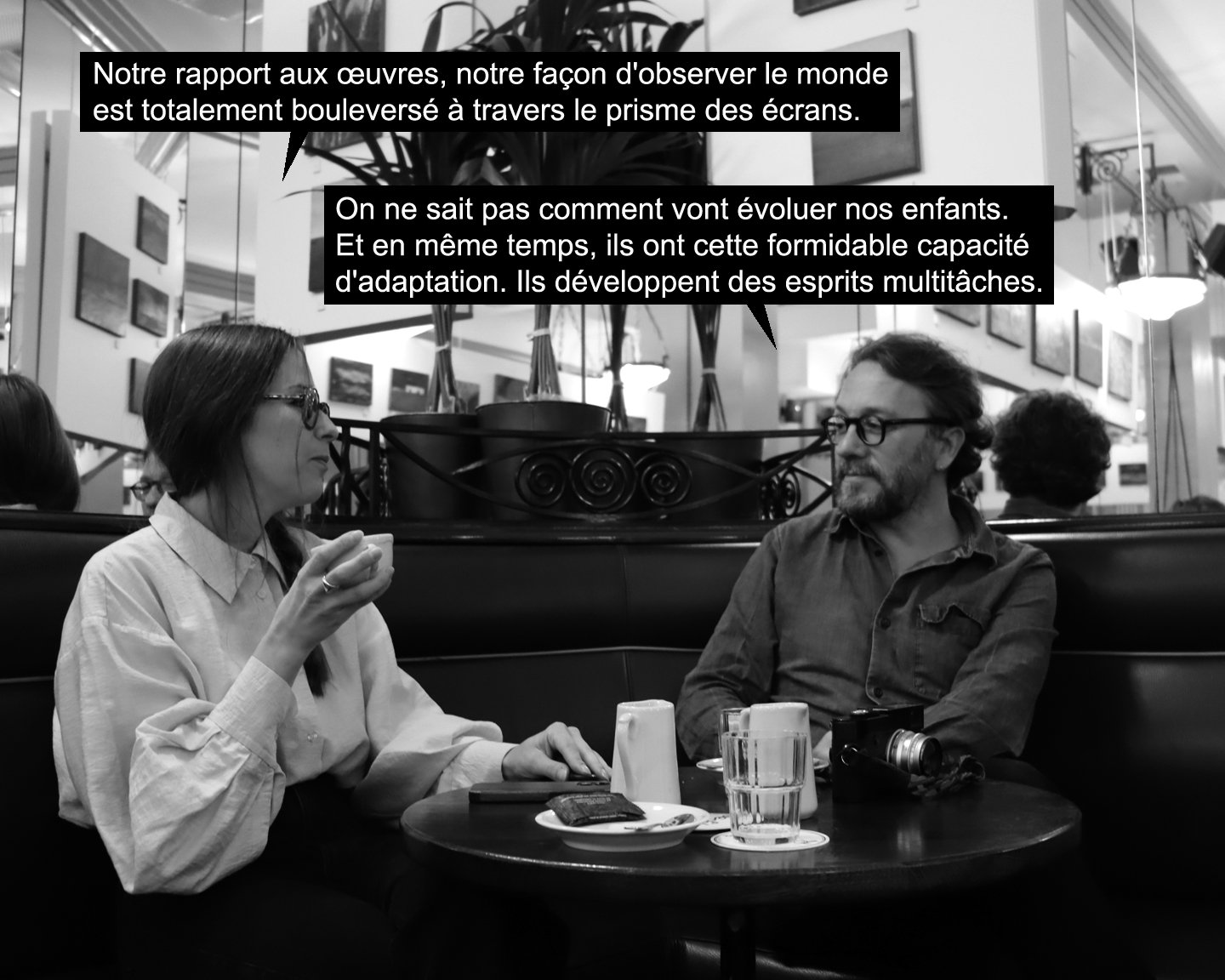



Lia : Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas pris un café ensemble !
Artus : 2009 quelque chose comme ça !
Lia : C'est dingue, j'ai l'impression que c'était hier... À cette époque, je me souviens que tu dessinais déjà. Même sur les nappes en papier des restos. Il me reste encore quelques croquis de toi. D'ailleurs, tu as conçu plusieurs fanzines à partir de tes dessins ?
Artus : Oui ! Aujourd'hui, il y en a 36 en tout. Là, je suis très content parce que je viens d’en faire un nouveau qui est plus dans la veine des trois premiers, juste avant que je ne me mettes à faire des dessins pour les magazines et la presse. J'ai réalisé que ça faisait vraiment longtemps que je n’avais pas dessiné pour moi. C'était assez dur de retrouver ce ton et ce trait un peu bête de mes débuts.
Lia : Quand on regarde tes illustrations, on reconnait ta plume, même quand ce sont des commandes.
Artus : À cause ou grâce aux commandes j’ai rapidement abandonné la plume Sergent Major pour dessiner avec des pinceaux puis des stylos pinceaux, plus rapides, moins encombrants, surtout quand je suis en voyage… Et puis, cet été j’ai rencontré un directeur artistique qui m’a fait essayer un Noodler’s Ahab. Et ça m’a immédiatement donné envie de redessiner « pour moi ». Ce sont des stylos plumes à cartouche, qui contrairement aux plumes de calligraphie ne sont pas biseautées. Du coup on peut appuyer dessus presque comme une brute, comme quand on est enfant, pour faire des pleins et des déliés, mais sans peur de les casser. Dans les années 20, il y avait beaucoup de stylos comme ça, mais il fuyaient beaucoup et étaient considérés comme des stylos de bureaux. On appelle ça des Flex nib... Il y a aussi le fameux Pilot 912 FA qui est super…
Lia : Passionnant. Raconte-moi comment tu as commencé le dessin...
Artus : Tu sais, je ne sais pas dessiner ! En réalité, je fais du détournement de mes propres images. J'ai commencé en décalquant mes vieilles photos numériques dont je ne savais pas quoi faire et sur lesquelles j’ai ajouté du texte pour les re-contextualiser… Du genre : « Il travaillait pour les meilleures marques de luxe, mais ce qu’il préférait c’était montrer sa bite dans des soirées branchés » (rires) quand je te disais que c’était bien bête ! Quand j’étais jeune, je voulais être dessinateur de BD, mais j’ai vite réalisé que c’était trop de travail de créer une image de toutes pièces. Je ne m’imaginais pas passer mes journées enfermé, penché sur une table lumineuse à imaginer des univers qui n’auraient existé que dans mon cerveau. J’avais une vraie volonté de me confronter à la réalité. Et puis, comme je dessine d’après photo, ça aurait couté trop cher en pellicules à l’époque. C’est grâce au téléphone portable que j'ai commencé à dessiner, avec des photographies en mauvaise définition. Et c’est aussi comme ça que mon ton « pince sans rire » est né (c’est le titre de mes fanzines en anglais : Deadpan).
Lia : Donc, tu imprimes les photos ?
Artus : Oui, je les passe d'abord en niveaux de gris hyper clairs jusqu'à ce que l’original disparaisse presque et puis je décalque au pinceau, à la plume, ou au Ahab ( !!!!), sans faire de retouche ni correction. Ça donne l'impression d'un dessin organique et bien fait. Les ratures, c’est parce que je suis hyper dyslexique. Finalement, mon travail est très proche de la photographie documentaire, les textes en plus.
Lia : Un peu comme les romans-photos. D'ailleurs, tu pratiques aussi la photographie sans intervention ?
Artus : Oui, j'ai un compte Instagram pour l'illustration et un autre pour les photos. Le sujet de mon fil Instagram sur le compte photo, je crois que c'est l'"invivabilité" du monde. Il y a à la fois des photographies de famille, mon quotidien avec Jessica et les enfants, et à la fois la beauté de la rue avec des saloperies par terre, les tâches, tout ce qui rend le monde beau et horrible. J'aime bien la confrontation des deux, même si ça ne marche pas à tous les coups. J’aimerais beaucoup réussir à faire un livre avec ces images.
Lia : Que ce soit tes illustrations ou tes photographies, on peut penser au fil d'un journal intime.
Artus : Oui, d'ailleurs, nous avons écrit un journal à quatre mains avec Jessica que nous avons publié tous les jours en Story sur Instagram durant le confinement. En fait, c'est toujours la réalité qui m'intéresse. Ce qui est génial avec les photographies de portable, c'est que celles qui sont ratées sont presque plus proches de la réalité. Tu essayes de prendre ce que tu as vécu, comme tu l'as vécu sans essayer de cadrer ou faire de belles images. La plupart des photos ne sont destinées à rien. On les met juste dans son ordinateur et voilà. Elles n'ont pas d'existence. Elles correspondent à un acte de chasser, de s'approprier ce qu’on voit ou de le voir deux fois (en vrai et sur l’écran), mais pas forcément de l'utiliser après.
Lia : Je vois complètement. Mon sujet de mémoire était sur les captures d'écrans et les écrans imprimés. Notamment, sur le geste même de capturer l'écran pour que notre cerveau imprègne l'image. Le geste prédomine la capture en tant qu'image d'image.
Artus : C'est-à-dire ?
Lia : L'acte de la capture permet au cerveau d'imprimer l'image au sein de sa mémoire alors même que l'image capturée finit souvent dans les oubliettes des archives 2.0. On va rarement consulter ses captures d'écrans mais on se souvient de ce que l'on a capturé parce qu'on a eu l'intention de la capturer et que le geste a matérialisé cette intention à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire ?
Artus : Oui, c'est Incroyable ! Jessica m’a récemment montré une conférence d’un des leaders de Snapchat durant laquelle il expliquait que le cerveau est plus sollicité lorsqu’il passe en mode réalité augmenté. Quand tu vas au musée, en général tu passes une ou deux secondes sur le tableau et une autre sur le cartel, ça fait trois secondes, mais quand tu photographies ce que tu vois, ça rajoute une seconde et pour peu qu’une information sur le tableau te soit délivrée à ce moment là, ça rajoute encore de l’attention. Cela dit, ce qui est dangereux avec le numérique, c'est que l'on ne mémorise plus ce qu'il y a devant soit, mais ce qu’il y a sur l’écran : ce qu’on a vu plus que ce qui est réellement.
Lia : Tout à fait. Quand je note mes listes de courses, je les photographies. Je ne me balade pas avec le papier et, la plupart du temps, je ne regarde même pas la photographie de la liste comme si elle s'était imprégnée dans mon cerveau au moment de la prise de vue. En fait c'est exactement ça, une prise de vue, une captation. C'est dingue quand on y pense.
Artus : C'est vraiment une mémoire extérieure, comme un disque dur. Tu sais que tu peux y avoir accès mais tu ne vas pas forcément y aller. Le fait d’avoir photographié ce que tu as vu a figé le moment et lui a donné une forme qui n’est pas vraiment la réalité pour trop vouloir lui ressembler. C'est une façon d'archiver.
Lia : Complètement oui.
Artus : L'ordinateur est un outil anthropomorphique. Il a été pensé un peu comme un cerveau. Je pense que quand tu fais des photographies, quand tu captures, tu crées un dossier, comme un compartiment dans un compartiment etc. Tu n’as plus un élément de la réalité qu’il faut aller chercher parmi des milliers de souvenirs, mais une réalité que tu as crée dans l’unique but de pouvoir la retrouver plus tard. Philip K. Dick, que j’adore, aurait parlé de simulacre de réalité. C’est le principe du répliquant dans Blade Runner. Je trouve ça hyper intéressant et flippant à la fois.
Lia : Tu évoquais les secondes d'attention face à un tableau. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore 20 ans, notre attention pouvait durer des minutes et des minutes. Aujourd'hui, on parle de secondes ! (rires) Notre rapport aux œuvres, notre façon d'observer le monde est totalement bouleversé à travers le prisme des écrans. On prend moins le temps de contempler une œuvre, même à travers l'écran.
Artus : On ne sait pas comment vont évoluer nos enfants. Et en même temps, ils ont cette formidable capacité d'adaptation. Ils développent des esprits multitâches. Ma fille, qui a deux ans et demi, fonctionne déjà à l'instinct face aux écrans. Quand on la laisse seule (mais attention pas plus de 5mn !) elle trouve elle-même son chemin, en totale symbiose avec les algorithmes de recherche de Youtube ou de Google, c'est fascinant.
Lia : L'enfant se laisse guider par ses intuitions.
Artus : Tu connais Hilma af Klint ?
Lia : Oui, j'aime beaucoup.
Artus : J'ai découvert son travail à travers mes recherches sur Rodolphe Steiner quand on a fait notre journal avec Jessica. Hilma était très liée à ce mouvement. Elle était allée voir Steiner pour obtenir des fonds ou recevoir de l’aide, un avis, je ne sais plus vraiment. Elle avait imaginé un musée en forme d'escargot sur une île, avec un éclairage zénithal qui serait descendu éclairer son œuvre etc. En fait, elle avait dessiné le Guggenheim au début du XXe siècle (elle est aujourd’hui considérée comme la première peintre abstraite !) ! Là où il y a eu sa rétrospective.
Lia : Tu veux dire qu'elle est à l'origine de l'architecture ?
Artus : On ne sait pas vraiment. Les mouvements anthroposophique et théosophique étaient liés aux énergies et aux ondes, à un rapport au monde basé sur l’intuition et le « suprasensible » - c'est pour ça que j'en parle. Hilma avait dessiné son musée idéal et il ressemble étrangement au Guggenheim !
Lia : Ah oui, on pourrait dire qu'elle était visionnaire mais n'est-ce qu'une coïncidence ?
Artus : C’est impossible de le dire, peut-être qu’elle avait vraiment « vu » son futur musée. L'histoire dit que ce n'est qu'un hasard. Mais apparemment, Solomon Guggenheim aurait été proche du mouvement anthroposophe. Ce qui est dingue, c’est qu’elle avait interdit de montrer ses œuvres de son vivant et disait qu’elles seraient exposées lorsque notre société atteindrait un paradigme – je crois avoir lu ça quelque part. Ce qui est dingue, c’est que son exposition a battu tous les records d’entrée du Guggenheim !
Lia : C'est fascinant.
Artus : Je me suis beaucoup intéressé à ces courants tout en pensant qu’il y a aussi quelque chose de très gênant dans leur approche. Le fait qu’ils croient dans la réincarnation et qu’ils pensent qu’il faut laisser s’accomplir le destin karmique des enfants, sous entend que nous ayons tous un rôle à jouer, ce qui est plutôt positif, mais d’après ce que j’ai lu, c’est au professeur d’identifier ce rôle dans lequel l’enfant se trouve par la suite bloqué par cycles de sept ans, alors que les enfants sont multiples et avancent tous à des vitesses différentes. Comme souvent dans l’enseignement tout dépend beaucoup de la personnalité des professeurs et, dans le cas des écoles Steiner Waldorf, de ses intuitions et du respect d’une philosophie qui est basé sur la connaissance d’un monde suprasensible qui ne serait accessible qu’à quelques initiés. Même si leur intuition est juste, c’est quand même très sectaire comme approche je trouve.
Lia : Le fait de mettre dans des cases est toujours ambigu, nous sommes des êtres complexes en mutation permanente.
Artus : Je ne sais pas si tu le sais mais l'agriculture en biodynamie est également liée à Steiner et à l’anthroposophie. Il y a tout plein de rituels autour de cette pratique, comme dynamiser l'eau, enterrer des crânes d’animaux domestiques avec des écorces de chêne, pulvériser des décoctions sur les champs…... Donc, en réalité, tous les vins fabriqués en biodynamie sont liés à ses pratiques magiques ! Très peu de personnes le savent.
Lia : Fascinant !
Artus : Steiner avait fait une conférence en 1924 (Cours aux agriculteurs) autour de ces procédés en se basant sur sa propre intuition, alors qu’il n’avait aucune pratique de la terre. Et aujourd'hui, ça cartonne. On dit même que ça marche, alors pourquoi pas, mais c’est assez fou quand on y pense.
Lia : Ça ne m'étonne pas. On m'a toujours apprit qu'il fallait dynamiser l'eau ! Ça doit être mon côté Suisse (rire). Masaru Emoto, un chercheur scientifique japonais, avait fait des études autour de molécules d'eau. Apparemment, l'eau subirait l'influence de nos pensées, paroles et sentiments. Beaucoup de croyances gravitent autour de l'eau et de son pouvoir.
Artus : Ah ça m'intéresse !
Lia : J'aimerais revenir au journal que vous avez commencé pendant le confinement avec Jessica. Où en êtes vous ?
Artus : On est en train d’essayer de mettre un point final au journal, ce qui est assez dur car un journal témoigne surtout d’un moment de vie. Cela représente déjà 600 pages ! Ce qui est dément, c’est que quand on a commencé à raconter notre premier confinement au jour le jour et à le publier sur les réseaux, on n’imaginait pas du tout qu’on serait aussi suivis et emportés par notre élan. Quand ils se sont servi du couvre feu pour arrêter des cambrioleurs dans un village voisin, un personnage nommé Raoul Troyès nous est tombé dessus sans qu’on l’ait vraiment décidé. C’est un agriculteur soi-disant anthroposophe et lié aux destructions d’antennes 5g, qui s’est incrusté dans notre récit avec sa femme Marla et qui y a rapidement pris de plus en plus de place. Ce personnage nous a permis d’aborder pleins de sujets qui nous intéressaient, jusqu’à carrément nous pourrir la vie. La fiction est peu à peu entrée dans nos vies et cela nous a beaucoup remis en question.
Lia : On peut dire que la fiction a dépassé votre réalité ! (rires)
Artus : Je crois qu'on a inventé un truc. C'est un journal avec un personnage qui s’incruste dans notre réalité jusqu’à la modifier. Dans la première partie du journal, il s’agit vraiment de nos vies, de notre réalité, puis dans la seconde partie il y a une part de fiction qui commence à s’immiscer pour ensuite se transformer en autre chose dans la troisième. J’ai lu quelque part que l’idéél, c’est la réalité intellectuelle. J’adore cette idée qu’il y ait plusieurs réalités et que la réalité de l’esprit ne soit pas moins vraie que la réalité matérielle. Ni supérieure, ni inférieure, juste égale.
à découvrir
à découvrir



