conversation
conversation
AVRIL BÉNARD
Écrivaine
Auteure du roman “À ceux qui ont tout perdu“, Avril nous questionne sur la valeur des choses, des objets, les liens humains sur fond d’une guerre dont on ignore les contours. Son ouvrage d’une grande humanité résonne particulièrement en cette période trouble.
Nous avons déambulé dans le Jardin du Luxembourg où nous avons questionné le sens des valeurs que l’on donne à ce qui nous entoure, nous avons également parlé de désir, de sacralité et d’urgence. Entre autres.
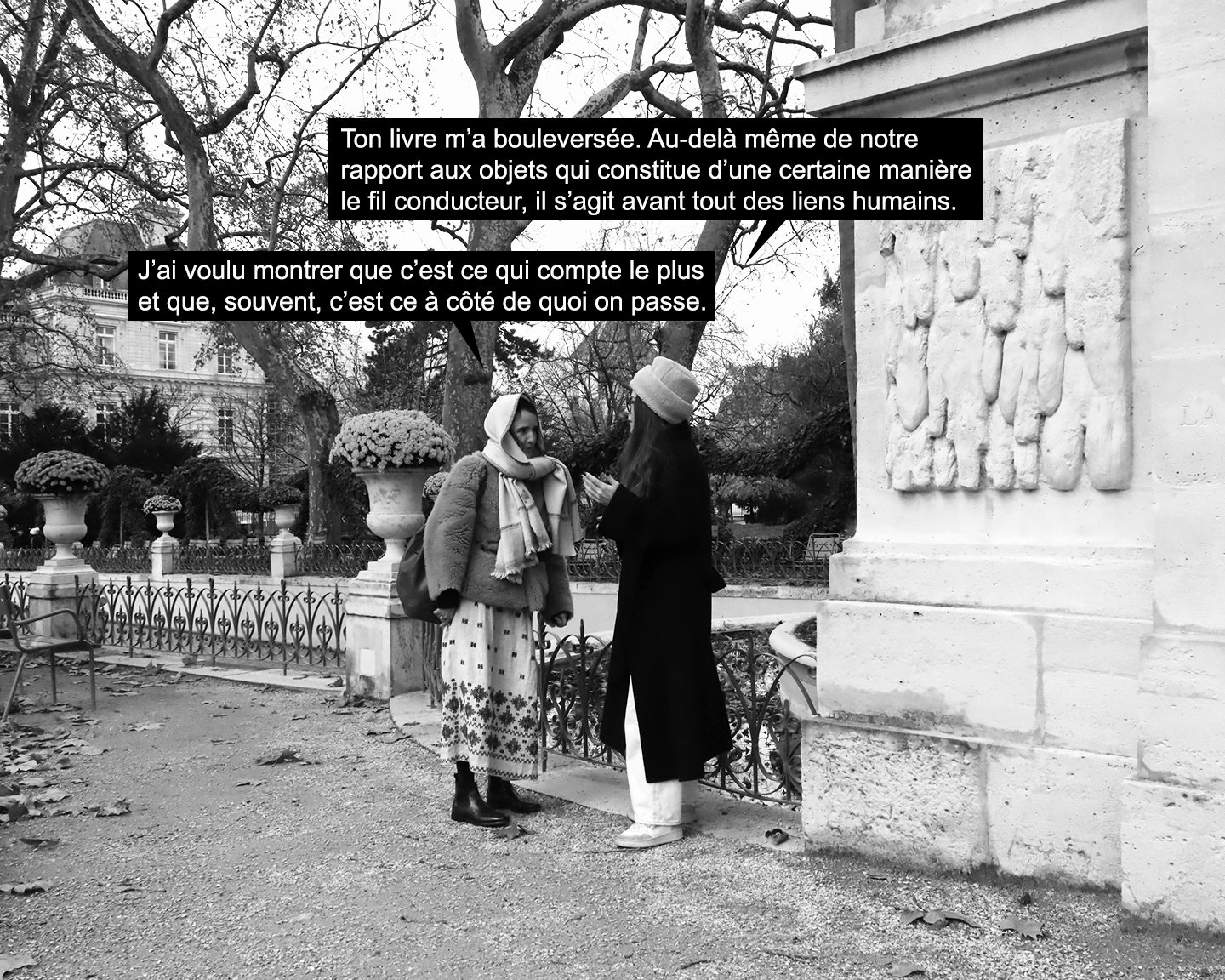
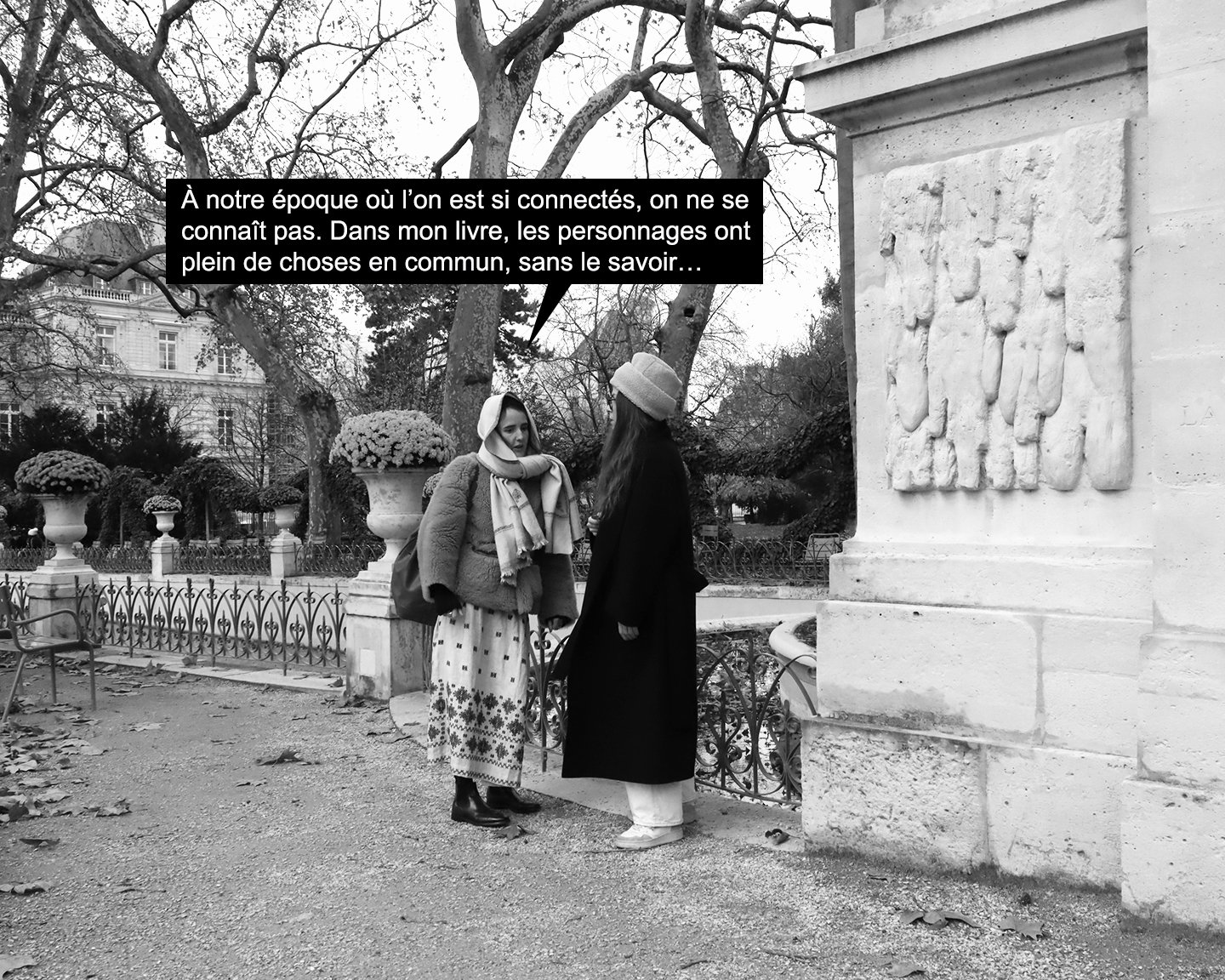
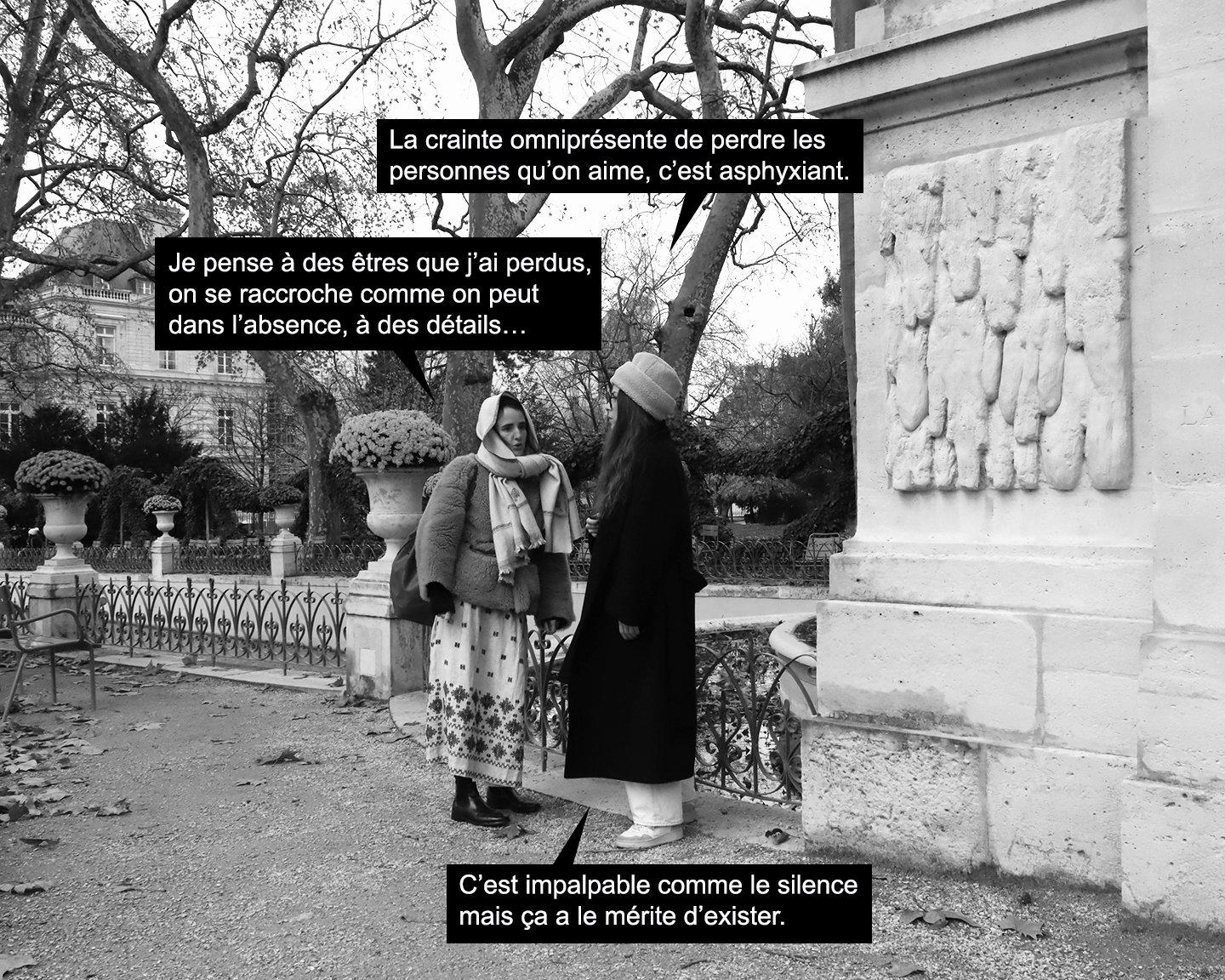
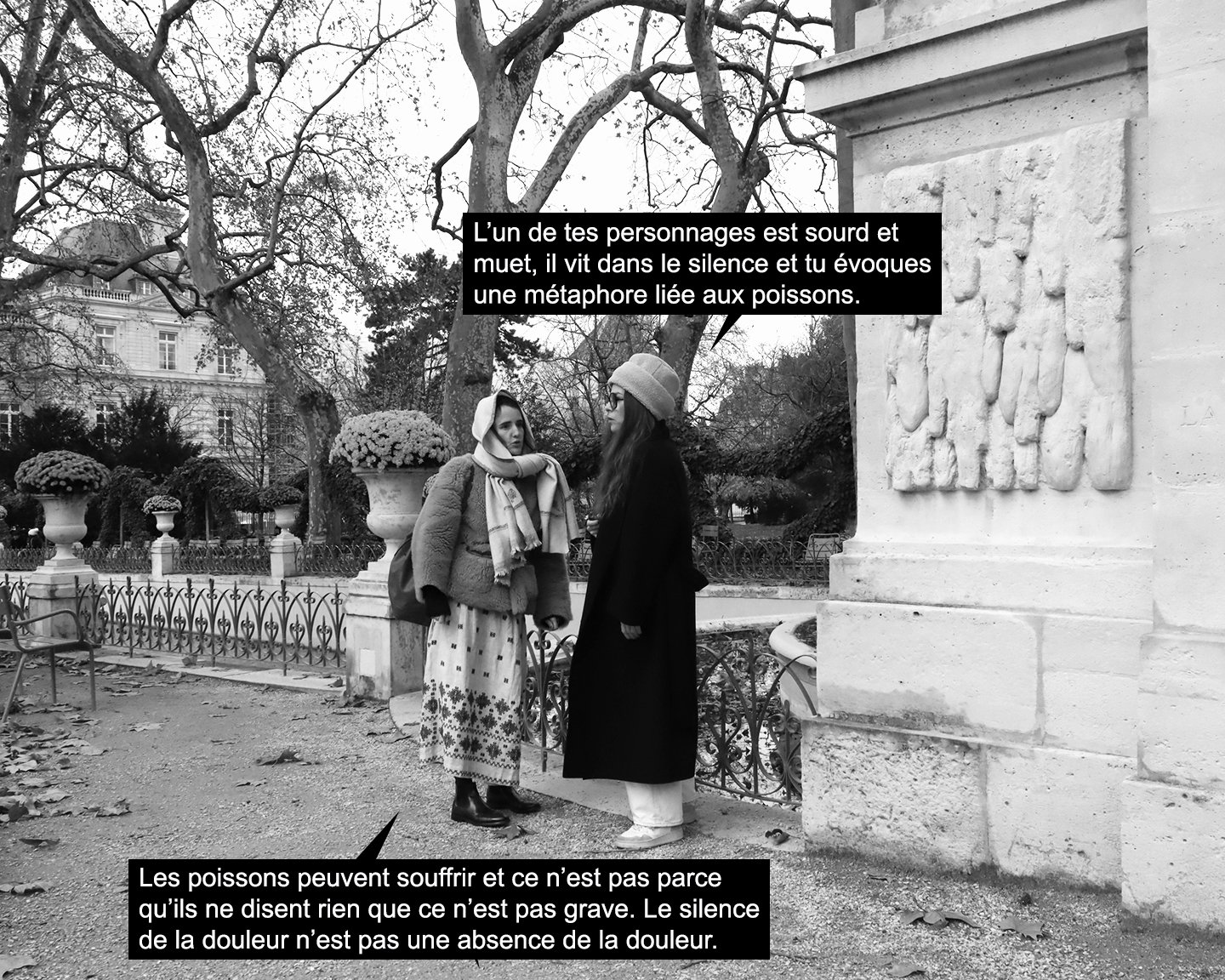
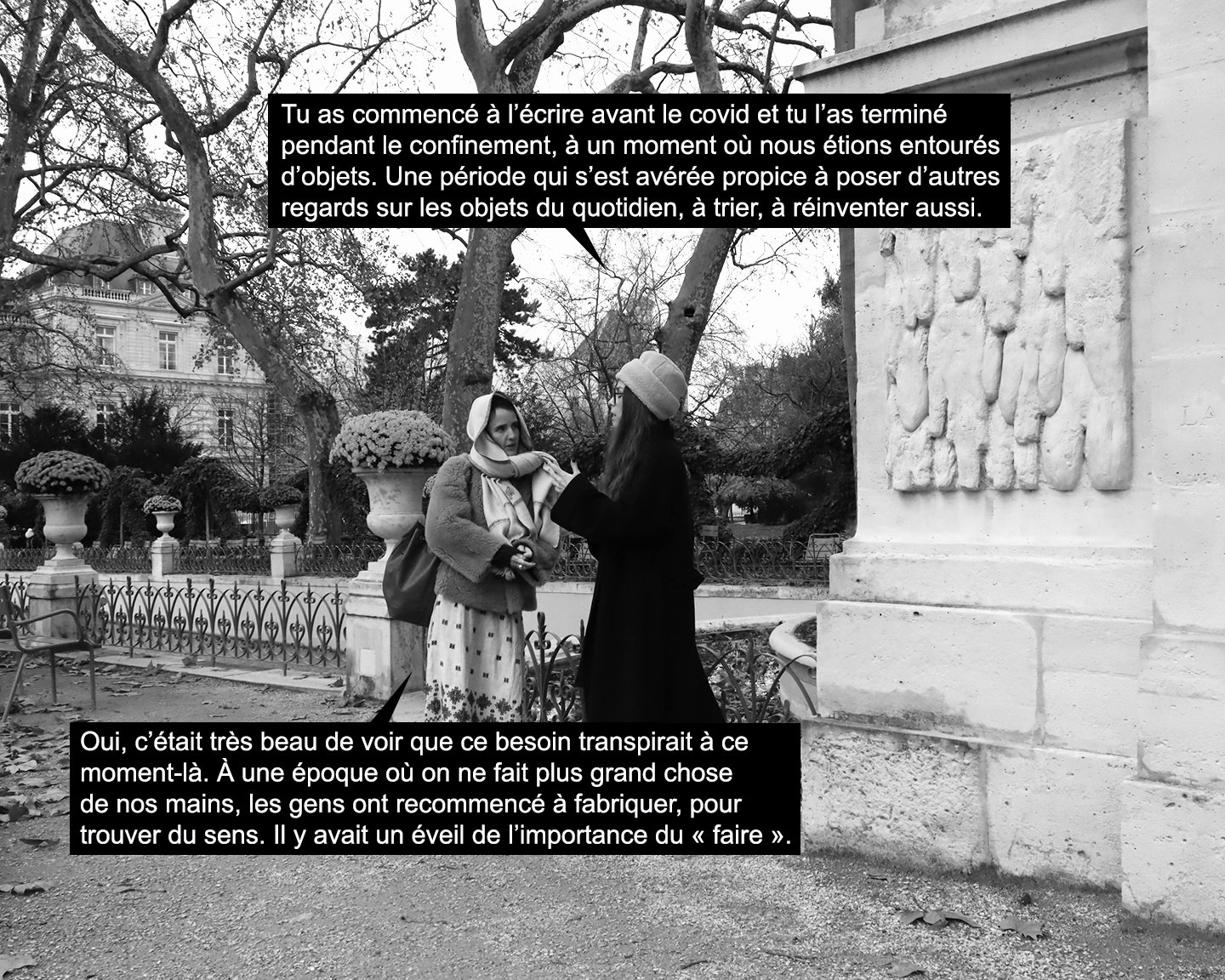
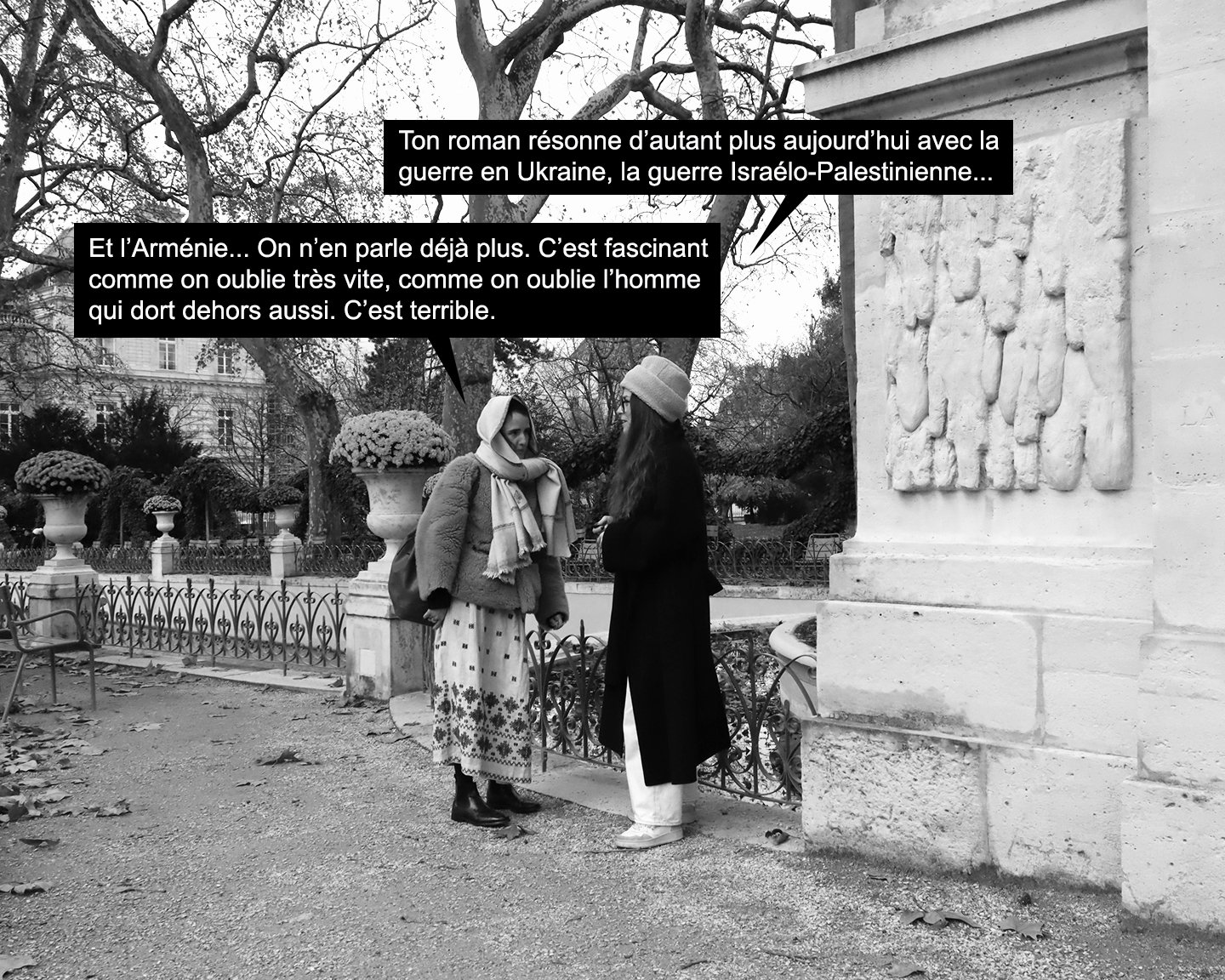


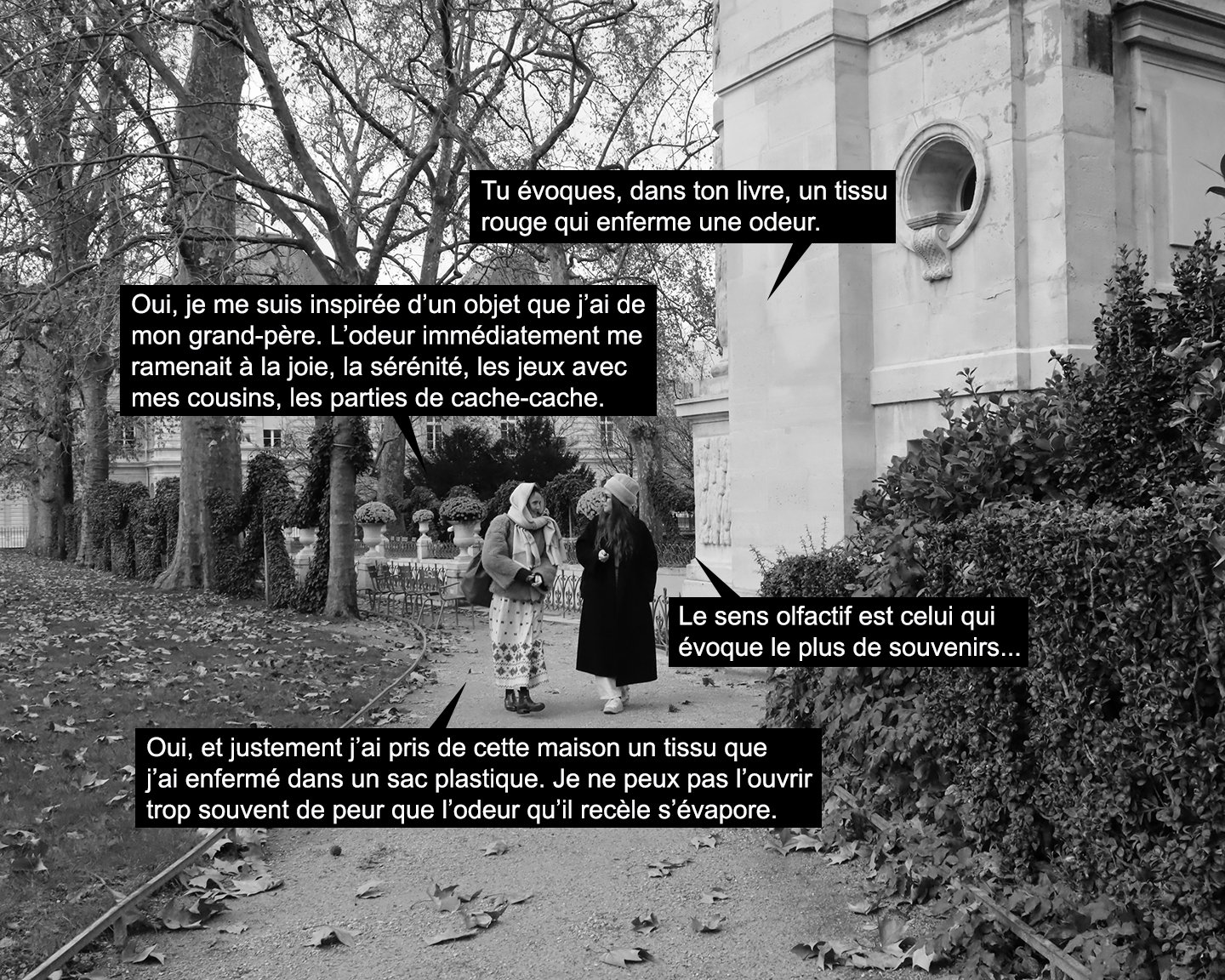

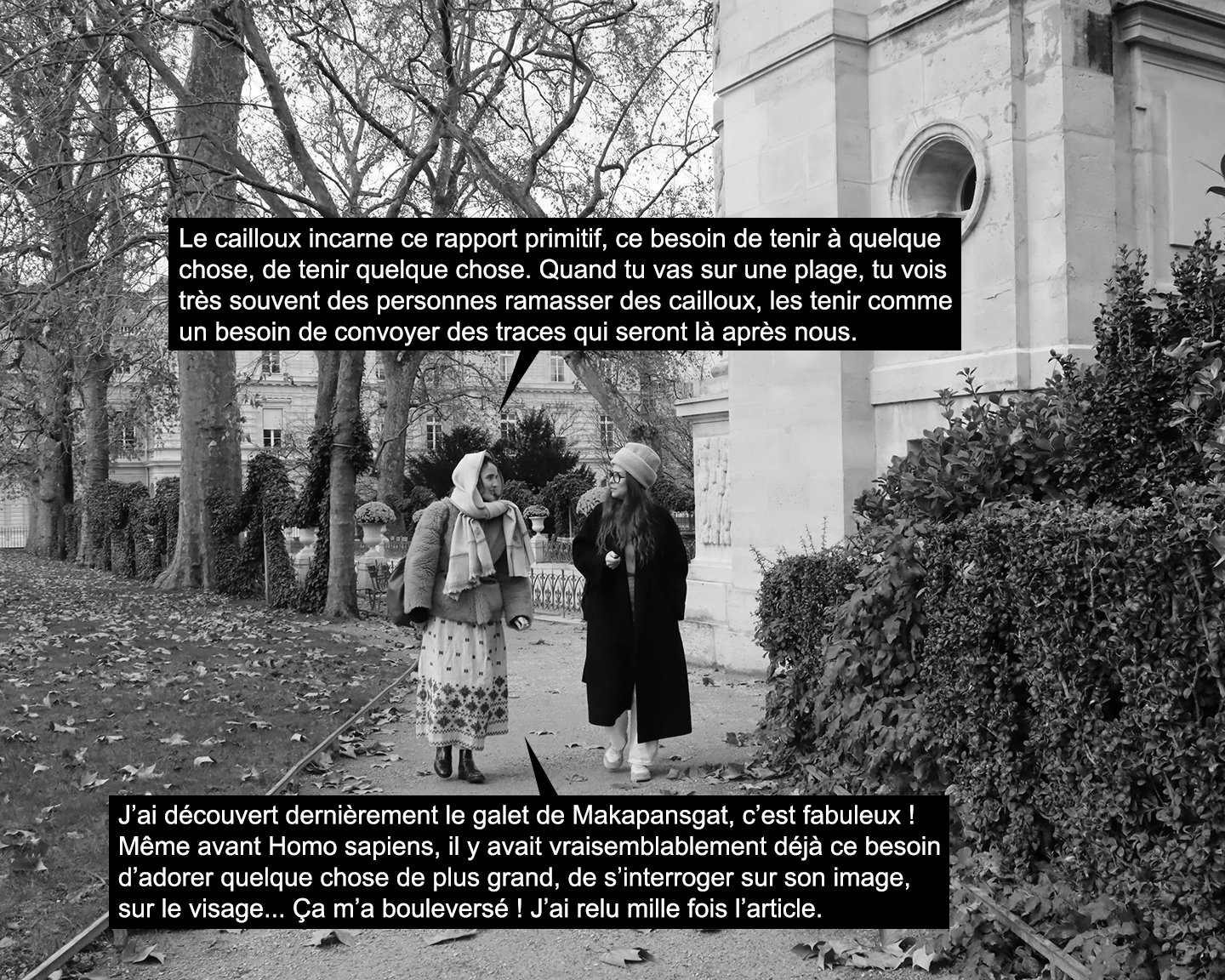
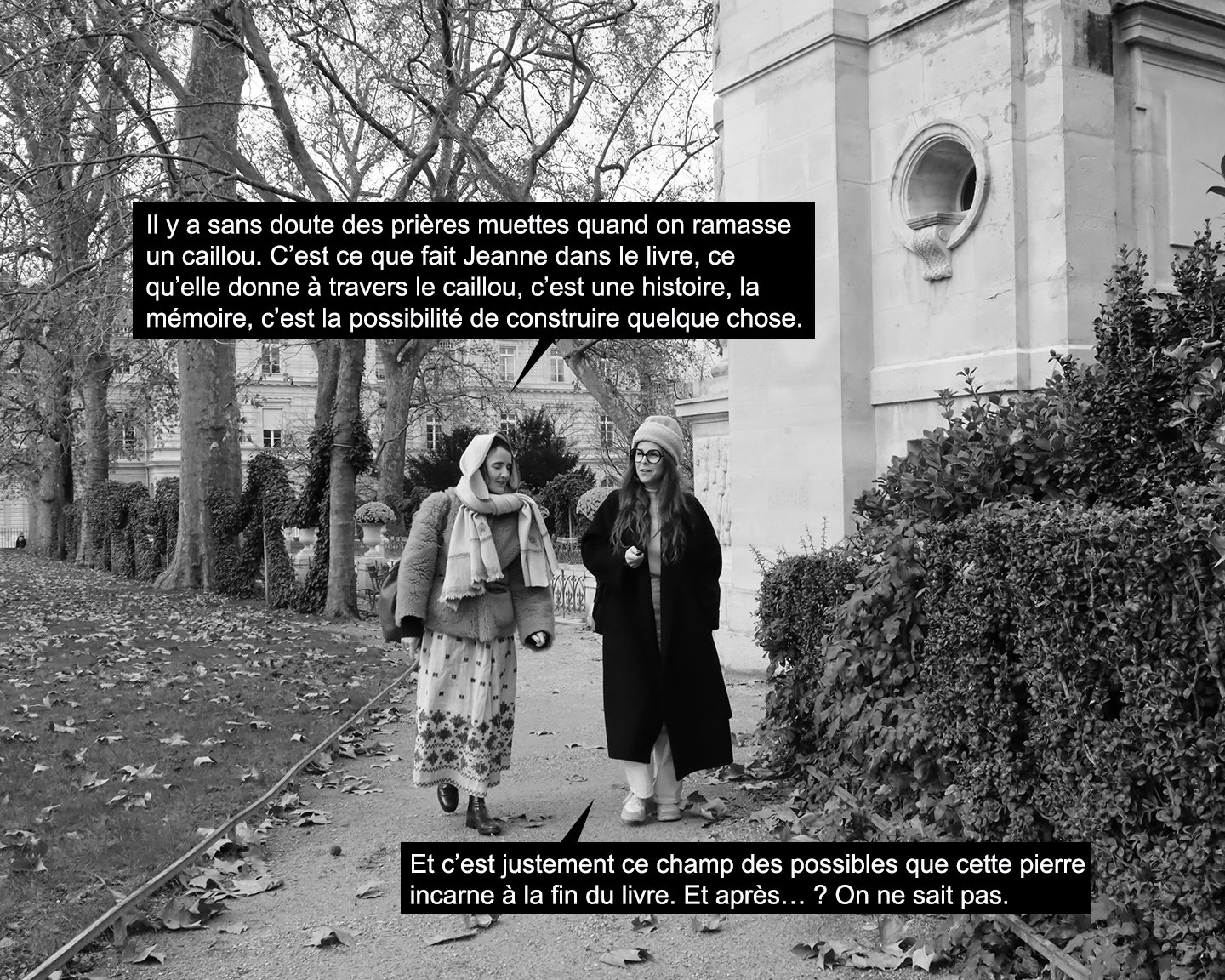
Lia : Ton livre m’a bouleversée. Au-delà même de notre rapport aux objets qui constitue, d’une certaine manière, le fil conducteur, il s’agit avant tout des liens humains.
Avril : Oui, j’ai voulu montrer que c’est ce qui compte le plus et que, souvent, c’est ce à côté de quoi on passe. À notre époque où l’on est si connectés, on ne se connaît pas. Dans mon livre, les personnages ont plein de choses en commun, sans le savoir…
Lia : Finalement, c’est ce que l’on projette sur l’objet qui compte réellement. Le thème de l’enfance est très présent dans ton livre, dès le premier chapitre, celui du « Je » où tu évoques ta propre enfance. Le regard enfantin, le rapport mère-fille est décrit avec une telle justesse notamment avec Jeanne et Manon. Ce qui me pousse à te demander si tu t’es inspirée de ta fille ?
Avril : J’ai commencé à l’écrire avant de devenir mère… Je me suis rendue compte que dans ma manière de le travailler, j’étais dans l’autre rapport, je me suis mise en tant qu’enfant. Comme toi, je suis très proche de ma mère. En l’écrivant, la gosse c’était moi.
Lia : Lorsqu’on est proche de sa mère, ce n’est pas évident de devenir mère à son tour, d’autant plus d’une fille.
Avril : Oui, c’est très dur. C’est colossal ce que tu traverses alors.
Lia : La crainte omniprésente de perdre les personnes qu’on aime. C’est asphyxiant.
Avril : Je pense à des êtres que j’ai perdus, on se raccroche comme on peut dans l’absence, à des détails…
Lia : Oui, dans l’absence, il reste la présence de ce qui nous a été transmis. C’est impalpable comme le silence mais ça a le mérite d’exister. D’ailleurs, dans ton livre, un de tes personnages est sourd et muet, il vit dans le silence et tu évoques une métaphore liée aux poissons.
Avril : Les poissons peuvent souffrir et ce n’est pas parce qu’ils ne disent rien que ce n’est pas grave. Le silence de la douleur n’est pas une absence de la douleur.
Lia : Ton roman est extrêmement humaniste. Tu as commencé à l’écrire avant le covid et tu l’as terminé pendant le confinement, à un moment où nous étions entourés d’objets. Une période qui s’est avérée propice à poser d’autres regards sur les objets du quotidien, à trier, à réinventer aussi, à faire avec ce qu’on a.
Avril : Oui, c’était très beau de voir que ce besoin transpirait à ce moment-là. À une époque où on ne fait plus grand chose de nos mains, les gens ont recommencé à fabriquer, pour trouver du sens. Il y avait un éveil de l’importance du « faire ». En tant qu’artiste, on est béni pour ça, on bidouille toujours quelque chose de nourricier, d’une manière ou d’une autre. A la période du confinement, c’était une prise de conscience plus globale.
Lia : Il m’arrive d’avoir une nostalgie de cette période.
Avril : Oui, moi aussi, d’une certaine manière…
Lia : C’était une autre temporalité. Ça sonne tellement loin... Ton roman résonne d’autant plus aujourd’hui avec la guerre en Ukraine, la guerre Israélo-Palestinienne...
Avril : Et l’Arménie... On n’en parle déjà plus. C’est fascinant comme on oublie très vite, comme on oublie l’homme qui dort dehors aussi. C’est terrible.
Lia : De nos jours, tout s’accélère, s’éclipse. On assiste à un ultra zapping.
Avril : Oui... J’entendais une journaliste se questionner autour de ça, elle n’avait pas de réponse mais c’était intéressant. Elle énonçait de quoi à quoi elle passait, par exemple de David Beckham à la guerre, à la façon de faire du pain, à un enfant éventré... Elle se demandait comment le cerveau est capable de zapper de l’horreur à la futilité absolue.
Lia : Je le perçois comme une forme de lavage de cerveau. On ressent de moins en moins d’empathie.
Avril : Ça rend bête, ça tue le désir. Tout à la même valeur, l’horreur est banalisée.
Lia : Je rebondis sur la notion de valeur, toi qui chine avec La Maison d’Avril, tu cherches en chaque objet son histoire, son essence. Quand on donne de la valeur aux objets, on dépasse la surface, la matière. Ton roman parle de tout ça.
Avril : Je me suis énormément posée la question de savoir ce que j’emporterais si je devais comme ça partir en une heure. La conclusion, c’est sans doute que je n’emporterais rien, je veux être capable de ne tenir à rien, enfin, il y a « rien » et « rien ». Tout chez moi est sacré, tout raconte une histoire. Je tiens à tout mais rien n’est important. Quand tu chines, il y a le fait que tu l’as chiné, tu te souviens du moment, tu te souviens du marchand. Un objet chiné contient tout un tas d’informations de l’ordre du conte. Et dans la manière de consommer actuelle, tu n’as pas tout ça. De plus en plus, on reçoit les choses à notre porte, ce n’est plus lié à un moment partagé avec des amis ou en famille ; ou avec soi-même, mais dehors…
Lia : La consommation immédiate a biaisé notre rapport au temps, nous devenons impatients et donc forcément ça bouleverse la valeur que l’on donne aux choses. Alors que les objets liés à une histoire, la nôtre ou celle d’autres, deviennent sacrés comme tu le dis.
Avril : Oui… Je vais raconter quelque chose : J’ai le couvre-lit dans lequel mon grand-père est mort, un patchwork qu’avait fait ma grand-mère. Je ne peux pas m’en servir, je l’ai roulé en boule dans une armoire mais je ne pourrais pas m’en séparer, c’est un linceul. Il y a aussi des objets douloureux qui nous entourent et dont on ne peut pas se séparer.
Lia : Tu évoques dans ton livre un tissu rouge qui enferme une odeur.
Avril : Oui, je me suis inspirée d’un objet que j’ai du même grand-père. Il y avait une odeur très particulière dans leur maison, que j’ai essayé de décrire… d’herbes sèches, de poussière… J’aimais immensément cet endroit, la maison a été vendue mais ma terreur était d’en perdre l’odeur. L’odeur immédiatement me ramenait à la joie, la sérénité, les jeux avec mes cousins, les parties de cache-cache.
Lia : Le sens olfactif est celui qui évoque le plus de souvenirs...
Avril : Oui, et justement j’ai pris de cette maison un tissu que j’ai enfermé dans un sac plastique. Je ne peux pas l’ouvrir trop souvent de peur que l’odeur qu’il recèle s’évapore.
Lia : À mon adolescence, un incendie s’était déclaré dans la maison de mes parents. Je me suis retrouvée face à un choix, quand tout part en fumée, le premier réflexe a été de sauver d’abord les chats, les êtres vivants, puis les albums photos, les archives familiales. Je crois que mon obsession des archives, des traces, vient de cet évènement.
Avril : Quand j’écrivais le livre, je me posais la question de savoir ce que j’emmènerais, question qu’on me pose souvent et à laquelle je n’ai pas encore de réponse. C’est impossible parce que c’est l’urgence qui sait ce qu’il faut emmener, ce qui est primitif, primordial, ce sont des choix de survie. Dans le calme, on prendrait trop de choses. Et le cailloux incarne ce rapport primitif, ce besoin de tenir à quelque chose, de tenir quelque chose. Quand tu vas sur une plage, tu vois très souvent des personnes ramasser des cailloux, les tenir comme un besoin de convoyer des traces qui seront là après nous. J’ai découvert dernièrement le galet de Makapansgat, c’est fabuleux ! Ce galet, qui par l’érosion évoque un semblant de visage, a été retrouvé près des restes d’un australopithèque, dans son poing fermé. Cet être est ainsi devenu le premier collectionneur, le premier adorateur connu de l’histoire de l’humanité. Même avant Homo sapiens, il y avait vraisemblablement déjà ce besoin d’adorer quelque chose de plus grand, de s’interroger sur son image, sur le visage... Ça m’a bouleversé ! J’ai relu mille fois l’article.
Lia : Comme tu l’as dit, c’est émouvant de prendre conscience que la pierre, les pierres étaient là avant et seront là après nous.
Avril : C’est ce face à quoi on se confronte, qu’on soit croyant ou pas, il y a sans doute des prières muettes quand on ramasse un caillou. C’est ce que fait Jeanne dans le livre, ce qu’elle donne à travers le caillou, c’est une histoire, la mémoire, c’est la possibilité de construire quelque chose.
Lia : Et c’est justement ce champ des possibles que cette pierre incarne à la fin du livre. Et après… ? On ne sait pas.
Avril : Si j’ai situé l’histoire dans une guerre, c’est parce qu’on est dans l’extrême, l’extrême de la peur, l’extrême de l’horreur, l’extrême de l’humain, la guerre bouche l’horizon. Et tu ne sais pas ce qui se passera la minute d’après. La menace est constante.
Lia : Dans cette urgence commune, celle de devoir tout laisser ou presque, le chapitre des «Deux âmes » m’a complètement secouée, on dépasse la matérialité. Le lien entre deux êtres demeure irremplaçable, tu le décris si bien que j’en ai pleuré. Et lorsque, dans le dernier chapitre, la petite Jeanne ramasse un caillou, tu montres à quel point les objets n’ont de valeurs que celle qu’on leur donne. Le caillou qui d’ailleurs, dans le judaïsme, incarne la filiation.
Avril : Oui, il s’agit de sacralité. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai cité Thomas Wolfe en épigraphe « Peut-être faisait-il partie d’une famille humaine, plus ancienne et plus simple, celle des bâtisseurs de mythes » (L’ange exilé). C’est ce que fait Jeanne, en ramassant et en offrant ce caillou, elle montre que l’on peut réécrire n’importe quelle histoire. Que c’est l’histoire qui compte. L’humain raconte des histoires, c’est peut-être ce qui le rend différent.
à découvrir
à découvrir



