conversation
conversation
BENOÎT PEETERS
Ecrivain, essayiste, professeur, scénariste et critique.
L’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à m’intéresser au genre du roman-photo, c’est grâce à l’ouvrage “Droit de regards” de Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart. Il y a quelques années, j’ai eu la chance de rencontrer et d’échanger avec Jan Baetens, spécialiste des romans-photos et co-fondateur des Impressions nouvelles avec Peeters.
Avec Benoît, à la suite de quelques échanges emails, nous nous sommes rencontrés pour la première fois un matin du mois de février au café le Fleurus, à quelques pas du Luxembourg.
Nous avons bien évidemment évoqué son attrait pour le genre du roman-photo, nous avons également parlé de l’audace juvénile, de la question de genre, de transgression, d’intemporalité, de Roland Barthes et de Jacques Derrida….
Entre autres.
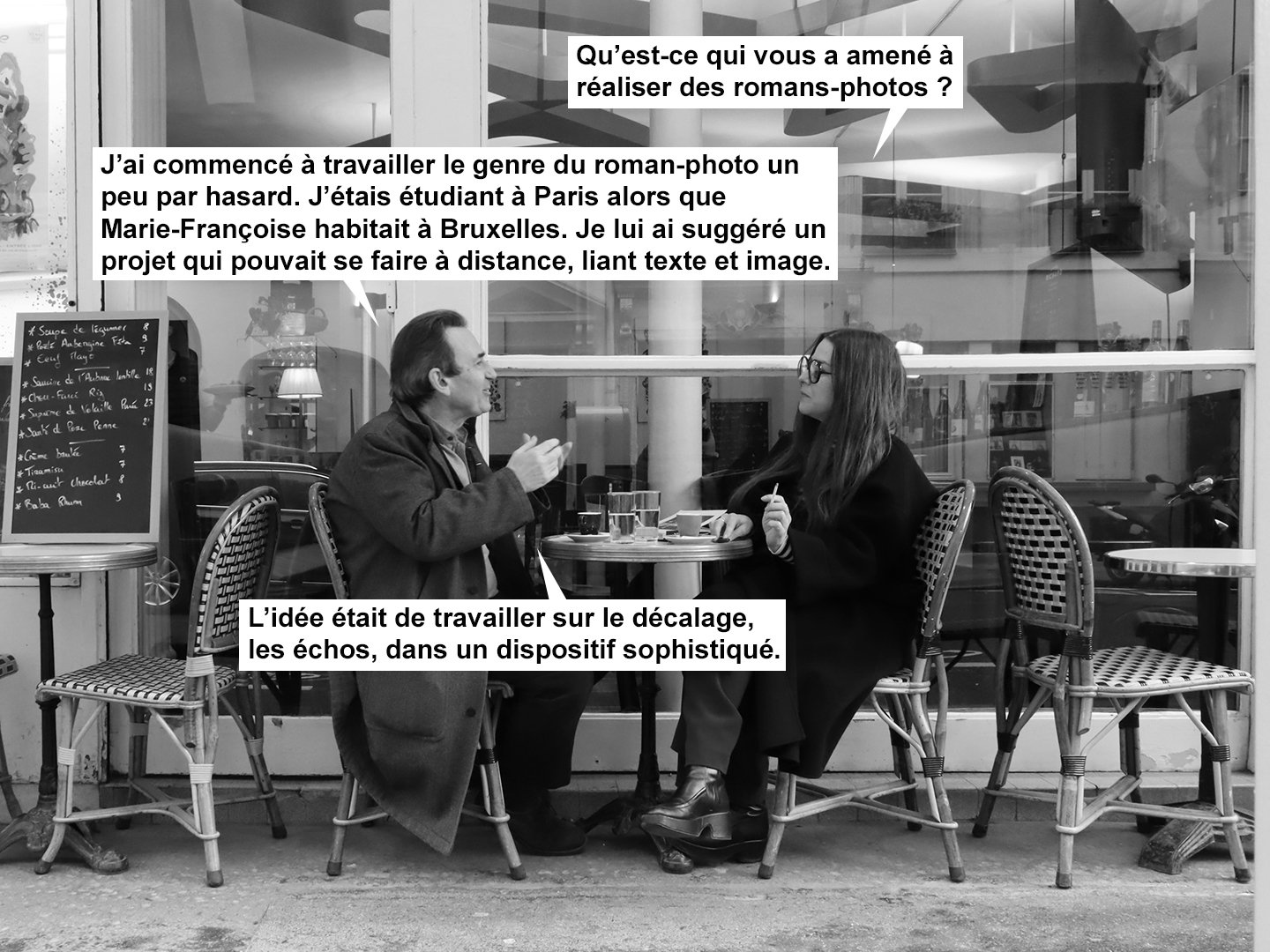


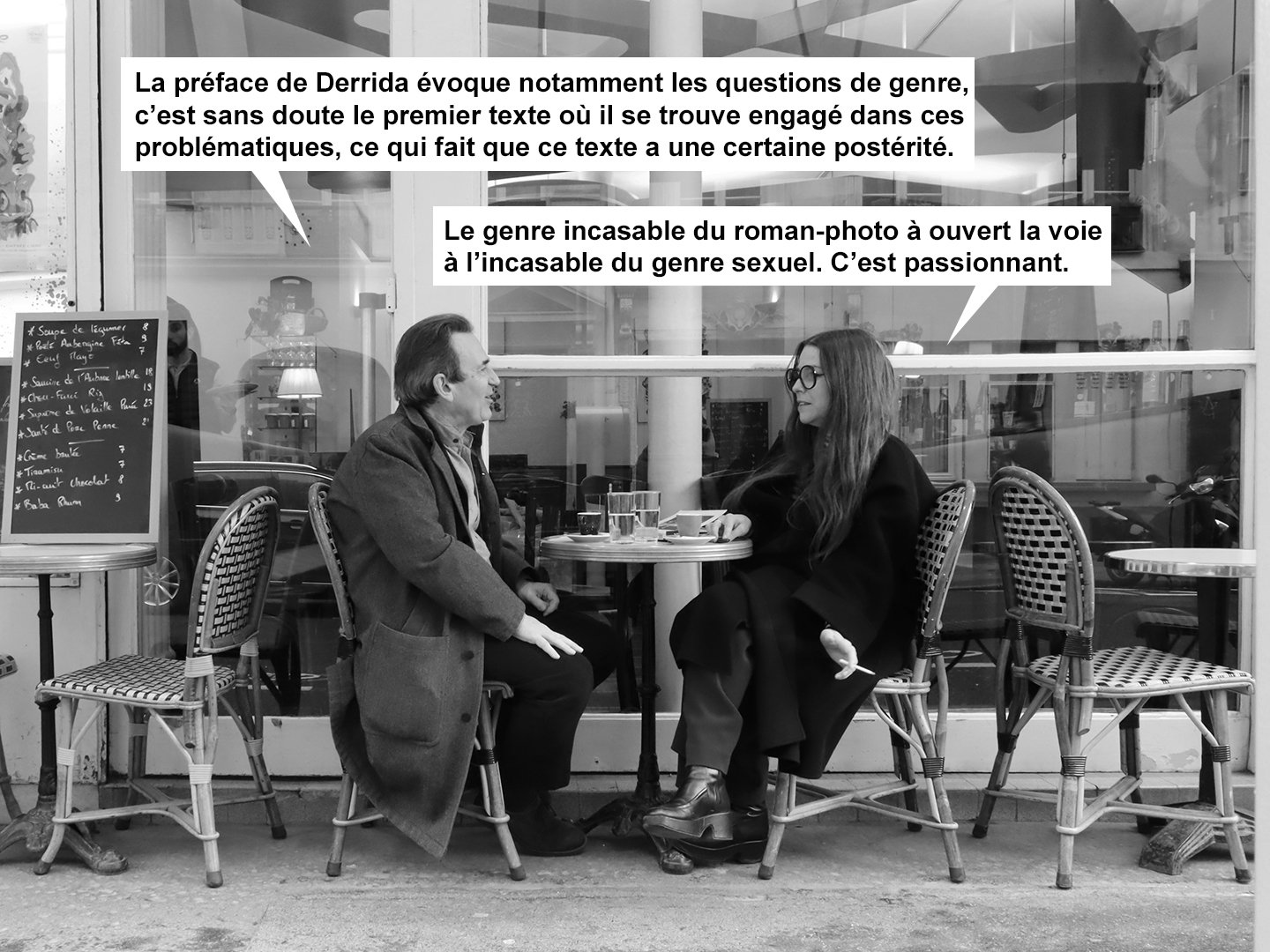


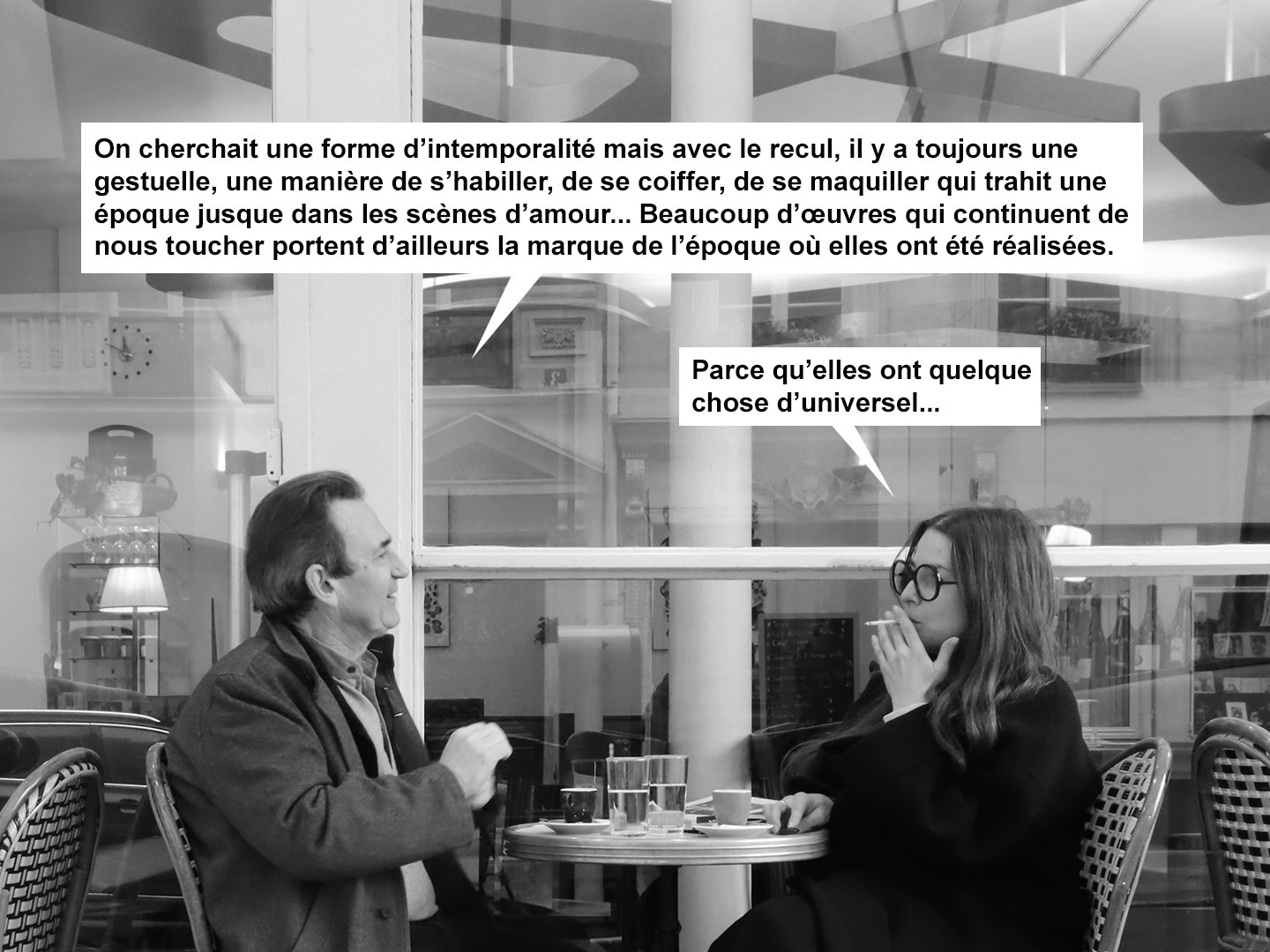


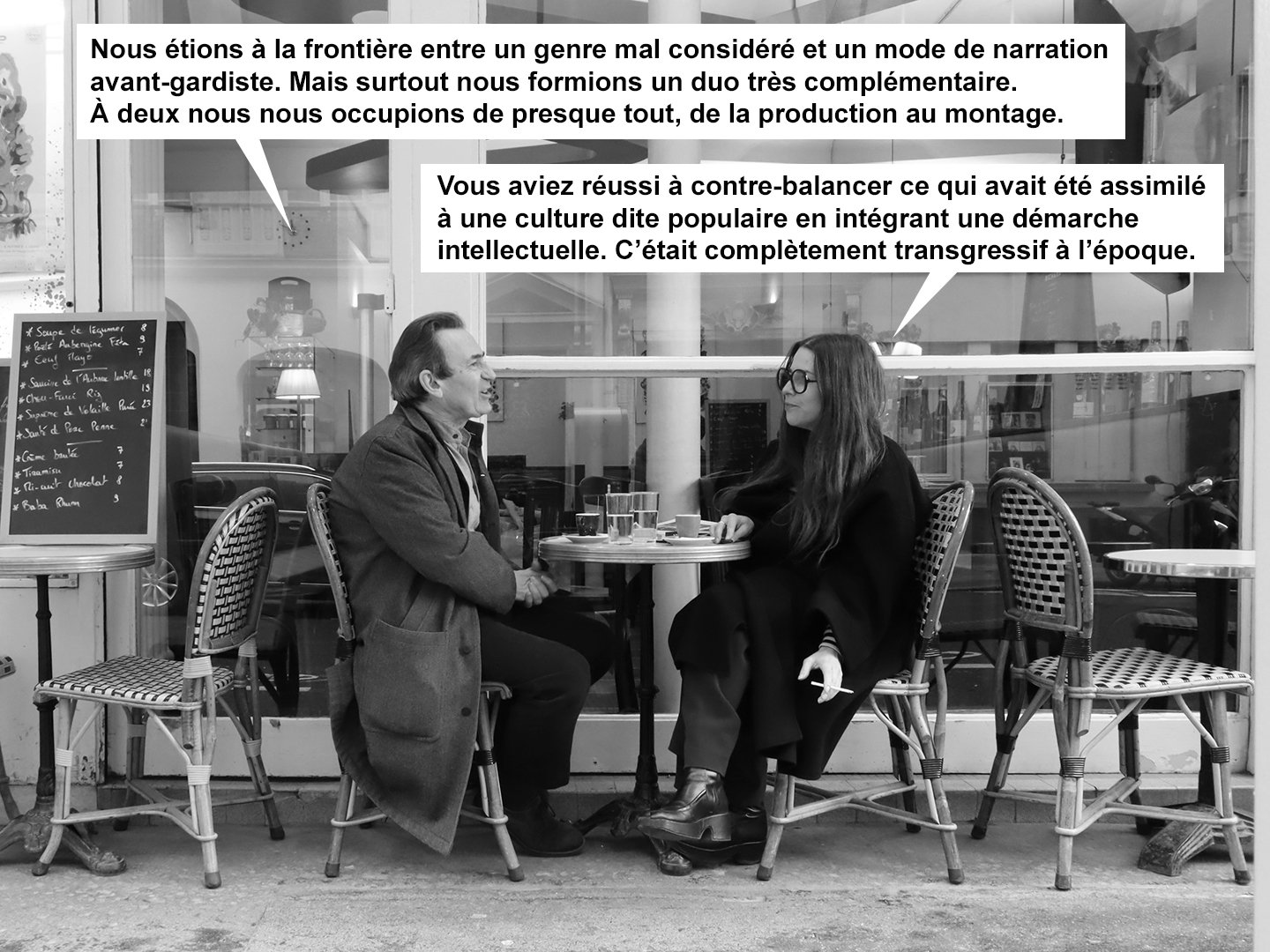
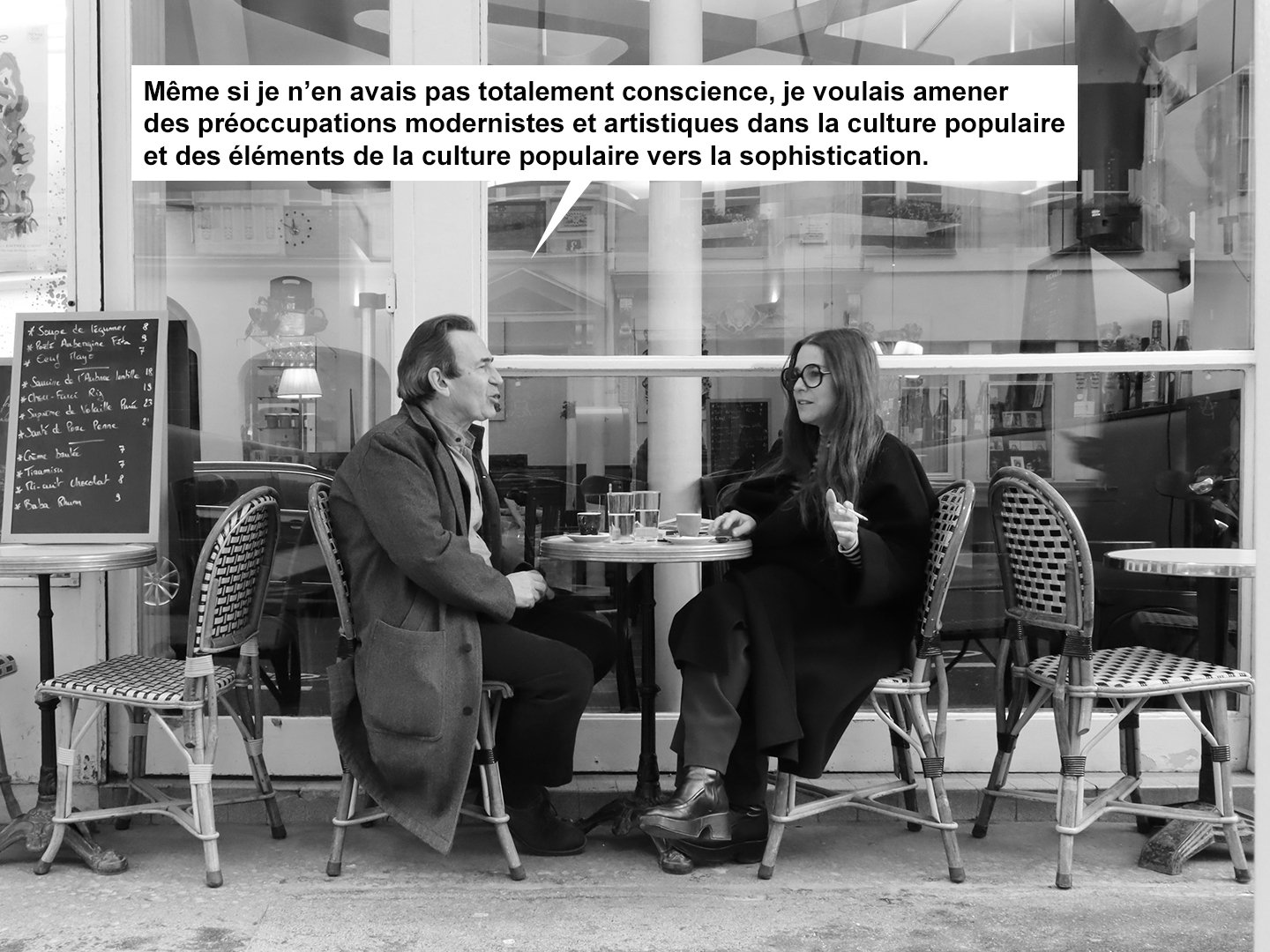
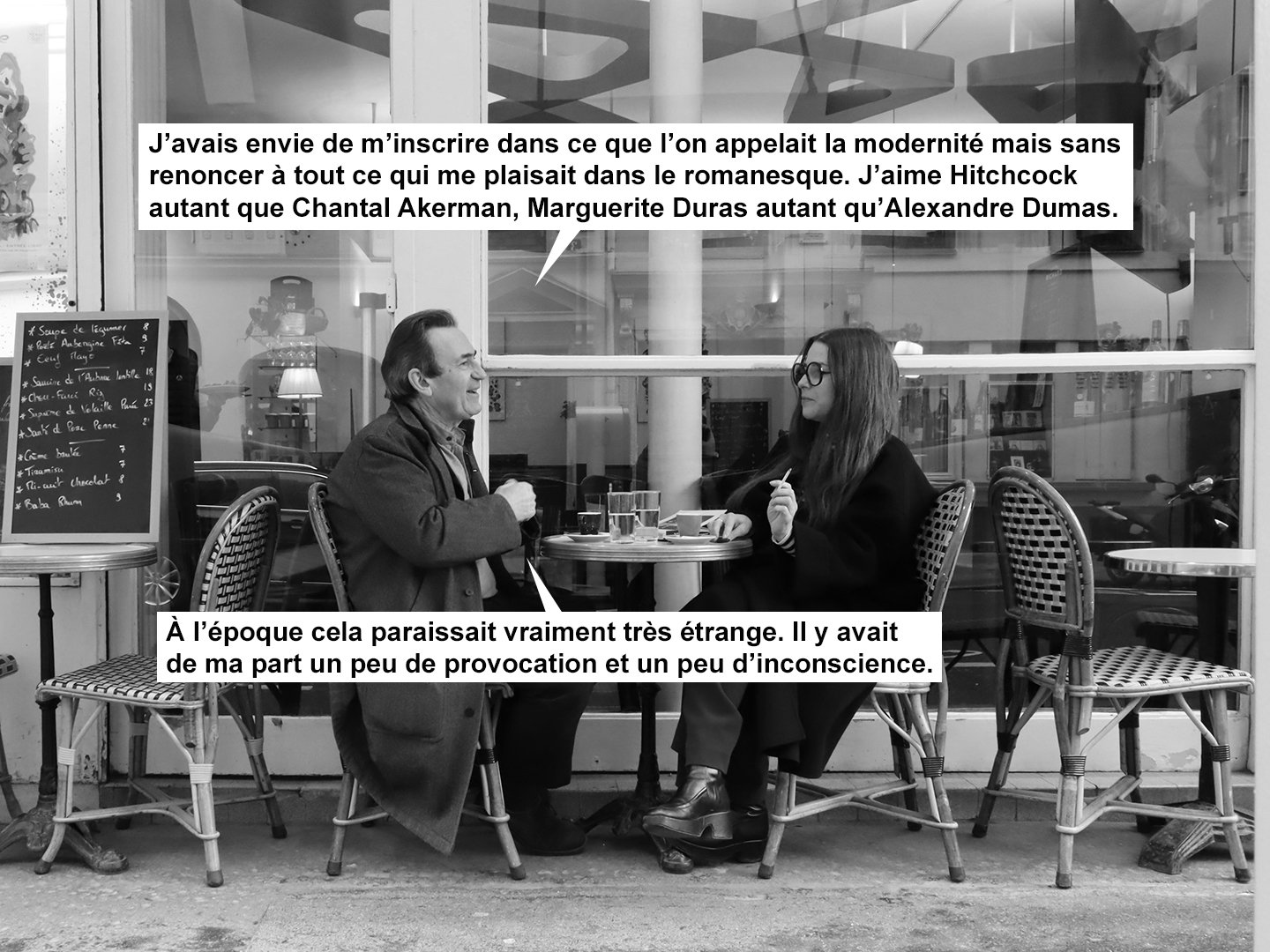
Lia : Parmi les romans-photos qui m’ont le plus inspirés, il y a les vôtres, ceux que vous avez réalisés avec Marie-Françoise Plissart. Je pense notamment à « Droit de regards » et « Fugues ».
Benoît : Il y a eu aussi « Le Mauvais œil » et « Prague » qui n’est pas tout à fait un roman-photo et plus tard il y a eu « Aujourd’hui » mais chez un éditeur qui a disparu.
Lia : Qu’est-ce qui vous a amené à réaliser des romans-photos ?
Benoît : J’ai commencé à travailler le genre du roman-photo un peu par hasard. J’étais étudiant à Paris alors que Marie-Françoise habitait à Bruxelles. Je lui ai suggéré un projet qui pouvait se faire à distance, liant texte et image. Marie-Françoise m’a envoyé une première photo et j’ai répondu par un petit texte. L’idée était de travailler sur le décalage, les échos, dans un dispositif sophistiqué. L’ensemble se composait de 5 x 5 textes et images. Le livre « Correspondance » a été édité en 1981 au moment où je m’étais installé à Bruxelles avec Marie-Françoise. Notre collaboration était indissociablement artistique et amoureuse. Avec mon ami d’enfance François Schuiten, la collaboration était créative et amicale. Je n’aime pas l’idée d’une collaboration purement professionnelle, pour moi il faut d’abord une entente, une vraie proximité. Quand on vivait ensemble à Bruxelles avec Marie-Françoise, jeunes, fauchés et plein d’enthousiasme, après ce livre qui reposait sur le battement entre le texte et l’image, on a eu envie d’aller vers quelque chose de plus narratif reprenant la forme méprisée du roman-photo. On s’est lancé dans des petits récits d’une douzaine de pages en imaginant que ça pourrait être publié dans la presse, mais nous nous sommes vite rendu compte que ce ne serait pas si facile, lespréjugés contre le roman-photo dans les années 80 étaient énormes. À l’époque, il y avait Bruno Léandri dans « Fluide Glacial » mais c’était parodique et très « BD ». Il y avait aussi des romans-photos sentimentaux. Nous ne voulions faire ni l’un ni l’autre. Nous voulions raconter des histoires avec des photographies. Nous avons commencé avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans moyens. Avec des ami.e.s, des lieux proches de chez nous, on s’appropriait peu à peu la technique. Tout était à découvrir. Il se trouve qu’à ce moment-là, en 1981, les éditions de Minuit ont publié un roman-photo qui s’appelait « Chausse-trappes » de Lachman et Levine.
Lia : Je vois très bien ! Il fait partie de ma collection, avec un texte d'Alain Robbe-Grillet en préface.
Benoît : Tout à fait, dans lequel il insiste surtout surle contrepoint entre le son et l’image chez Eisenstein. Mais il émet aussi l’idée que possiblement le roman-photo est un genre. C’était encourageant… Mon premier roman, « Omnibus », était paru aux éditions de Minuit, en 1976, mais j’avais eu ensuite une petite brouille avec Jérôme Lindon, le directeur de la maison. C’est donc Marie-Françoise qui est allée présenter notre ensemble de récits courts chez Minuit. Lindon s’est montré immédiatement enthousiaste, je ne sais pas si c’est du projet ou de Marie-Françoise (rires), mais finalement nous avons pensé que cela ferait un livre trop court et nous nous sommes lancé dans un projet plus ambitieux, un récit policier qui est devenu « Fugues ». Même si le livre n’a pas connu un grand succès, il a été remarqué et nous a donné un début de légitimité. Nous avons commencé un nouveau projet, en nous disant que ce serait un livre sans texte, un livre où la photo respire pleinement : « Droit de regards ». Ce livre nous a dépassés, on l'a fait dans un état de grâce. On avait accès à des lieux magnifiques, on avait de nombreux complices, il y avait les fantasmes de Marie-Françoise…
Lia : Même sans mots, la scénarisation est telle que le texte est sous-entendu à travers la sémiologie des images. C’est vraiment bluffant.
Benoît : On avait tenté de trouver des subventions mais comme ce n’était ni vraiment de la photo, ni vraiment de la littérature, il n’y avait pas de commission adéquate. On n’avait pas d’argent, mais on s’est débrouillé. À l’automne 83, on a présenté le projet à Jérôme Lindon. Il a dit que c’était magnifique, mais selon lui l’absence de texte rendaitle projet invendable. Il insistait pour qu’on ajoute du texte, une préface au moins. Alors, j’ai lancé le nom de Jacques Derrida ! (Rires) Il était déjà un philosophe célèbre, mais je ne le connaissais pas encore personnellement. Lindon a dit avec un grand sourire : « Eh bien, revenez avec une préface de Derrida et je publie le livre ». Manifestement, il n’y croyait pas. On a écrit une belle lettre à Derrida et sollicité un rendez-vous pour lui montrer les planches. Il a répondu qu’il était débordé, mais intrigué par notre projet et il nous a proposé un rendez-vous. Derrida a regardé le livre lentement,avec une grande attention, et nous a dit : « C’est d’une violente beauté… Si j’avais le temps, j’écrirais volontiers quelque chose ». Nous lui avons répondu :« Prenez le temps qu’il faudra, on vous attendra ». À la fin de l’été 1984, il nous a téléphoné en disant que c’était bien plus long qu’une préface, il avait déjà écrit 70 pages.
Lia : Quelle émotion ! Vous deviez être tellement touchés.
Benoît : Avec ma naïveté juvénile, je lui ai répondu :« Il va falloir songer à conclure ». Il était d’accord. On a reçu le texte, magnifique. Le livre est paru quelques mois plus tard, il a suscité un vif intérêt et a été traduit en plusieurs langues. La préface de Derrida évoque notamment questions de genre, c’est sans doute le premier texte où il se trouve engagé dans ces problématiques, ce qui fait que ce texte a une certaine postérité.
Lia : Passionnant, comme quoi le genre incasable du roman-photo à ouvert la voie à l’incasable du genre sexuel.
Benoît : Alors que la problématique émergeait à peine, le texte évoque « le trouble du genre » dans tous les sens du terme. Derrida avait regardé et lu de façon extraordinaire. Lors d’une conférence à Vienne, il a déclaré : « Ce sont des photographies de langue française, des photographies intraduisibles ». Par exemple, le jeu de dames, qui est au cœur du livre, n’a plusieurs sens qu’en français.
Lia : Un peu comme un rébus, des jeux de mots et d’images.
Benoît : Tout fait et je crois que c’est l’un des éléments qui a séduit Derrida, cette idée du langage sous l’image. Il y a par exemple un moment dans « Droit de regards » où l’on ouvre des tiroirs y découvrant l’amorce d’une nouvelle séquence : un récit à tiroirs. Si l’on ne perçoit pas ces jeux, ce n’est pas grave, on fait d’autres associations, d’autant que le livre a une dimension très sensuelle.
Lia : Plus tard, vous avez écrit la biographie de Derrida, la seule existante d’ailleurs.
Benoît : Oui, c’est ironique, jamais il n’aurait pu penser que ce jeune homme qui lui avait présenté un livre bizarre avec son amie photographe allait un jour écrire sa biographie. En 2007, trois ans après la mort de Derrida, sa femme m’a donné l’autorisation, elle m’a dit que Jaques m’appréciait beaucoup et que, s’il devait y avoir une biographie, elle était prête à me faire confiance. Grâce au lien établi depuis « Droit de regards ». J’ai mis trois années très denses à écrire ce livre. J’ai lu ou relu toute son œuvre, j’ai rencontré une centaine de témoins, j’ai fouillé dans ses immenses archives… J’avais l’impression qu’un fantôme bienveillant me regardait écrire, je voulais être digne de cette grande ombre. Je pense souvent à ce fil invisible qui nous relie, à la présence des morts, à travers le souvenir qu’ils nous laissent, à travers des rencontres dont on n’avait pas réalisé sur le moment à quel point elles étaient importantes. La vie est faite de hasards, de portes ouvertes, de croisements. Sans l’aventure de « Droit de regards », je n’aurais sans doute pas écrit la biographie de Derrida. Derrida m’avait ouvert sa porte, comme Roland Barthes quelques années plus tôt, et j’espère leur avoir rendu quelque chose de la générosité dont ils ont fait preuve à mon égard.
Lia : Comme avec Alain Robbe-Grillet ? Vous aviez de l’admiration envers lui avant de le rencontrer ?
Benoît : Oui, bien sûr, j’avais lu ses livres avec passion. J’ai eu le culot de lui envoyer mon premier texte, en 1975, et il m’a immédiatement répondu. C’était une période où de grandes figures comme lui restaient accessibles.
Lia : Avant de préfacer « Chausse-trappes », il avait réalisé avec Resnais le film apparenté au genre du ciné-roman « L'Année dernière à Marienbad », un ovni dans le paysage cinématographique.
Benoît : Oui, le film avait été écrit minutieusement par Robbe-Grillet et filmé magiquement par Resnais. Il a obtenu le Lion d’or au festival de Venise en 61. Le film était à la fois extraordinairement fidèle au scénario et extrêmement différent, notamment par la présence de Delphine Seyrig. C’était une source d’inspiration importante pour Marie-Françoise et moi, tout comme « La Jetée » de Chris Marker, certains films de Duras et de Godard, et le roman visuel « La Cage » de Martin Vaughn-James.
Lia : Autant d’inspirations allant du dessin, au film et à l’image animée.
Benoît : Plus que d’une influence, il s’agit d’un climat lié au Nouveau Roman et à ce qu’on appelait la modernité. On avait le sentiment de s’engager dans une nouvelle direction… Au moment de réaliser « Droit de regards », on cherchait une forme d’intemporalité mais avec le recul, il y a toujours une gestuelle, une manière de s’habiller, de se coiffer, de se maquiller qui trahit une époque jusque dans les scènes d’amour. Il y a un côté daté, involontaire, mais qui ne me gêne pas. Beaucoup d’œuvres qui continuent de nous toucher portent d’ailleurs la marque de l’époque où elles ont été réalisées.
Lia : Elles ont quelque chose d’universel...
Benoît : Oui, les deux choses sont compatibles.Certains artistes voudraient atteindre directement le classicisme, mais cela ne se décide pas. Parfois,malgré les années, les décalages et l'oubli des références, l'œuvre continue à toucher… Quand on a réalisé « Droit de regards », on ne savait pas vraiment ce qu’on voulait faire mais on savait ce qu’on ne voulait pas faire. On a travaillé par morceaux, le projet ne cessait d’évoluer mais le désir profond qui se cachait derrière les scènes nous restait obscur.
Lia : Et pourtant, c’est une œuvre avant-gardiste qui a encore une portée autant stylistique que narrative et qui marque les prémices des réflexions sur le genre grâce à la préface de Derrida.
Benoît : Oui, cela reste un très beau souvenir. Après l’accueil positif de « Droit de regards », nous nous sommes sentis encouragés à poursuivre l’aventure. Nous avons réalisé un autre livre « Le Mauvais œil » qui combine texte et image de manière très différente. Il y a eu aussi un projet plus romanesque, « Prague », édité chez Autrement.
Lia : Parallèlement aux romans-photos, vous réalisiez aussi des bandes dessinées ?
Benoît : Oui, j’ai commencé à pratiquer la bande-dessinée avec François Schuiten au même moment. Autant les libraires ne savaient pas où classer les romans-photos, autant il y avait une place pour la bande-dessinée qui prenait de nouveaux chemins. Très vite, il y a eu une dissymétrie entre le caractère confidentiel de nos romans-photos et le succès des premières bandes dessinées. Mais les deux genres me passionnaient. Et vers la fin des années 90, j’ai vu l’intérêt revenir autour des romans-photos, notamment comme sujets de mémoire. Alors on a réédité « Droit de regards » aux Impressions Nouvelles, la maison d’édition dont je m’occupe avec Jan Baetens, qui lui-même a beaucoup travaillé sur le roman-photo. Il y a eu la grande exposition au Mucem, vos romans-photos, un début de reconnaissance…
Lia : Le roman-photo reste cependant « incasable ». Je pense notamment aux bourses de recherches artistiques, le genre ne correspond ni à la BD, ni à la photo, ni à la littérature. Finalement, ce manque de classification n’a pas changé depuis « Droit de regards ». Ça reste encore à contre-courant.
Benoît : il y a quelques éditeurs comme FLBLB qui revendiquent le mot « roman-photo ».
Lia : Mais qui restent proches de la bande dessinée. Je ne vois pas d’éditions de romans-photos contemporains proches de ceux que vous réalisiez.
Benoît : Nous étions à la frontière entre un genre mal considéré et un mode de narration avant-gardiste. Mais surtout nous formions un duo très complémentaire. À deux nous nous occupions de presque tout, de la production au montage.
Lia : Vous aviez réussi à contre-balancer ce qui avait été assimilé à une culture dite populaire en intégrant une démarche intellectuelle. C’était complètement transgressif à l’époque.
Benoît : Même si je n’en avais pas totalement conscience, je voulais amener des préoccupations modernistes et artistiques dans la culture populaire et des éléments de la culture populaire vers la sophistication. Par exemple, j’avais proposé à la revue « Minuit », une revue littéraire d’avant-garde, un grand entretien avec Hergé, ce qui était subversif à sa façon. Et dans mon deuxième roman, « La bibliothèque de Villers », je me réclamais à la fois de Borgès et d’Agatha Christie. J’avais envie de m’inscrire dans ce que l’on appelait la modernité mais sans renoncer à tout ce qui me plaisait dans le romanesque. J’aime Hitchcock autant que Chantal Akerman, Marguerite Duras autant qu’Alexandre Dumas. À l’époque cela paraissait vraiment très étrange. Il y avait de ma part un peu de provocation et un peu d’inconscience. Quand j’étais étudiant à l’École pratique des Hautes Études avec Barthes, je lui ai proposé de travailler sur « Les bijoux de la Castafiore » : il n’avait aucune réticence, mais le reste de l’université française n’aurait jamais accepté un tel projet. Je me souviens d’ailleurs qu’à l’automne 79, lors d’un rendez-vous avec Barthes je lui ai montré notre tout premier roman-photo qu’il a regardé avec curiosité. Je ne savais pas qu’il écrivait « La Chambre claire ». Jan Baetens cite souvent le mot de Barthes à propos des romans-photos, où il évoque prudemment « une vérité d’avenir (ou d’un très ancien passé) » de ce genre méprisé. Après la mort de Barthes, en mars 1980, j’ai arrêté mon parcours universitaire. Comme bien d’autres, j’avais perdu mon seul interlocuteur. Deux mois après son décès, je suis retourné à l’École pratique et j’ai rencontré Christian Metz, spécialiste du cinéma qui m’a dit : « Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire de vous ? ». C’était refroidissant. Et puis un jour mon ami Pierre Fresnault-Deruelle m’a proposé de passer une habilitation sur travaux, ce que j’ai fait en 2006-2007, associant les fictions et les travaux de réflexion.
Lia : Incroyable ! Lorsque j’ai étudié l’Esthétique de l’art, j’ai eu Pierre Fresnault-Deruelle comme professeur en sémiologie de l’image.
Benoît : Tout s’est passé pour le mieux, sauf que pendant la soutenance, je n’ai pas pu présenter des images. J’ai dû parler des images en leur absence.
Lia : Est-ce l’origine du livre « Écrire l’image » ?
Benoît : Tout à fait. Et dans le livre, j’ai pu ajouter des images.
Lia : La boucle est bouclée.
à découvrir
à découvrir



